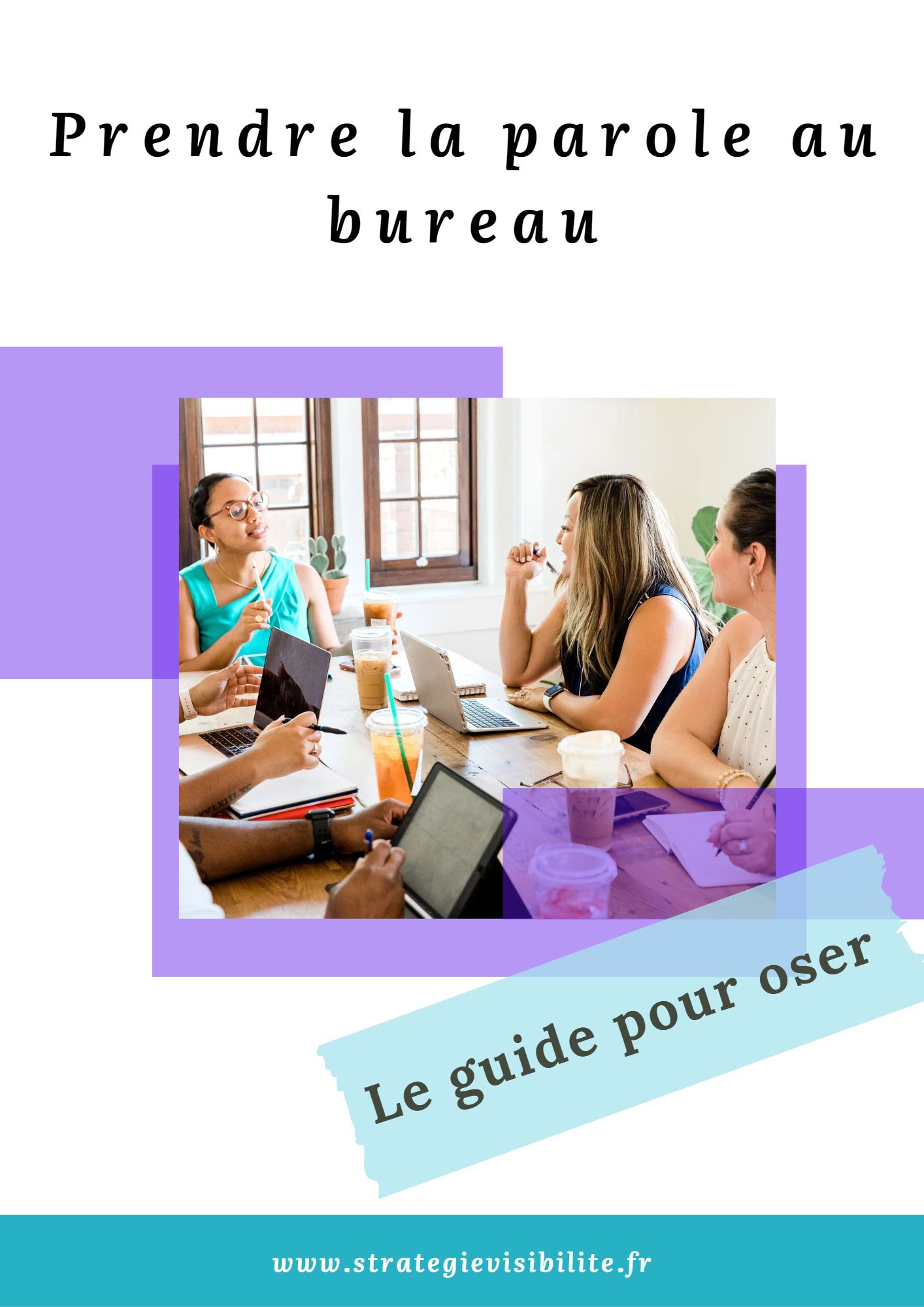C’est quoi une prise de parole engagée ?
Et ça veut dire quoi prendre la parole pour défendre une cause ?
L’ancienne lobbyiste que je suis, te dirait qu’une parole engagée c’est toute prise de position qui défend un intérêt.
Bouh, lobbying est un mot qui fait peur. Oui je sais, mais y’a pas que des gros méchants en costards qui le pratiquent.
J’ai exercé uniquement dans le milieu de l’économie sociale et solidaire, par exemple. (Alors oui, pardon, le politiquement correct dans le milieu associatif, c’est de parler de plaidoyer. Je t’épargne les subtilités de définition, parce que c’est pas l’objet de cet article !)
Donc oui, défendre une cause, c’est défendre un intérêt.
Dans le cas de la prise de parole engagée telle que je la conçois, et telle que je la développerai tout au long de cet article, il s’agit d’un intérêt collectif, voire d’intérêt général.
Et cette définition est très large. Parce que toute parole politicienne partisane, par exemple, entre dans cette définition. En France, Monsieur Z et Madame L (dont je ne cite consciemment pas les noms) portent des paroles engagées, aka, des intérêts collectifs qu’iels pensent fermement être d’intérêt général. (Reste que toute idée n’est pas une opinion et que certains propos sont des délits, mais là encore ce ne sera pas le sujet de cet article.)
Une prise de parole engagée, c’est donc une parole militante à mon sens.
Elle se porte de multiples façons, surtout à l’aire des médias sociaux et d’Internet.
Et le sujet de cet article c’est de décortiquer non pas les formes de ces prises de paroles, mais d’analyser qui porte des paroles engagées, ce que cela implique et comment s’y prendre.
Qui prend la parole pour défendre une cause ?
Si pendant des années le militantisme était associé à l’idée d’une organisation claire avec des porte-paroles identifié·es et des organisations d’événements (des conférences-débats, autant que des manifs’), la parole engagée est aujourd’hui partout.
Porter une parole engagée, ce n’est donc pas (plus) uniquement faire un discours très construit en 5 parties devant des médias traditionnels ou hurler en manif’.
Aujourd’hui comme hier, on porte une parole engagée dans des chansons (Hexagone de Renaud à jamais dans mon cœur d’enfant), des œuvres d’art, des manifs’, des événements, mais aussi :
- dans des articles de blog ;
- dans des posts Instagram ou LinkedIn ;
- dans des vidéos Youtube ou TikTok ;
- des podcasts – ce média au moins autant révolutionnaire que la radio libre en son temps et qui permet à tant de femmes de parler hors des contraintes de l’audimat et des institutions patriarcales ;
- des chaînes sur Discord (si tu ne sais pas ce que c’est, t’es pas officiellement has been, t’inquiètes !).
Au risque d’être parfois plus diffuse et affaiblie… encore que.
On pourrait avoir un débat sur l’utilité des t-shirts à messages (notamment féministes) : est-ce que c’est le degré zéro de l’engagement, ou est-ce que c’est justement la preuve que le message arrive dans des sphères nouvelles ? A ce sujet, je vous recommande le livre de Jennifer Padjemi : Féminismes et Pop culture, ça vaut le détour !
Mais si les formes de ces prises de parole ont changé, est-ce que les personnes qui les portent ont changé aussi ?
Oui et non…
-
Les porte-paroles politiques, associatifs, ou syndicalistes
Ce sont celles et ceux auxquels on pense le plus spontanément quand on pense « porte-parole ».
Notre imaginaire collectif se représente facilement les portes-parole avec des attributs stéréotypés et sans nuances :
- Les porte-paroles des politiques sont en costard ou tailleurs. Ils et elles disent des trucs devant des caméras sur des plateaux télé, défendent les projets (bons ou mauvais) des groupes politiques qui les emploient ;
- Les porte-paroles associatif·ves sont en jean (ou en sarouel selon la mouvance), écrivent des tribunes ou des courriers aux politiques et les rencontrent sans croire à leurs promesses, font appel aux dons du public, organisent des événements généralement festifs et conviviaux. On les voit peu dans les médias, parce qu’ils et elles sont « sur le terrain » ;
- Les porte-paroles syndicalistes brûlent des pneus devant les usines, organisent des manifs’ auxquelles viennent les copines et copains associatifs, disent des trucs dans les médias comme les politiques et revendiquent des chiffres 3x plus gros que ceux des autorités publiques.
Tout ça (avec la dose énorme de stéréotypes que j’ai listée), ce sont des personnes qui portent des paroles engagées, qui défendent des projets, des visions, des intérêts collectifs. Qui font du lobbying / plaidoyer.
Peu de changements de ce côté-ci (si ce n’est que ces stéréotypes sont ce qu’ils sont : des exagérations sans nuance et les lignes sont bien plus floues). Et si tu es, toi aussi, une porte-parole associative, tu sauras où ajouter les nuances. Cet article promet d’être long, je la joue courte sur ce point.
-
Les entrepreneur·euses militant·es
Dans notre imaginaire collectif, les affaires et le militantisme ne font pas bon ménage.
Y’a comme une dissonance cognitive qui naît dans notre esprit quand on allie les deux concepts, non ?
Et pourtant… les entreprises portent des projets de société.
Toutes ? Oui.
Mais celles qui réussissent le mieux financièrement ne sont pas celles qui réussissent le mieux sur le plan éthique.
D’une part parce que ce qui rapporte de l’argent se fait souvent sans regarder les dommages collatéraux (les fameuses « externalités négatives » de tes cours d’éco) et d’autre part parce que dès que l’on parle éthique, on a du mal à y associer de l’argent.
Un exemple ? Le bio, c’est bien, mais pourquoi c’est si cher ?
(spoiler : parce que c’est l’agro-industrie pleine de produits phytosanitaires qui a artificiellement tiré les prix vers le bas sans payer les dommages collatéraux sur la biodiversité…)
Et dans les business tenus par des féministes, c’est pareil.
On m’a déjà reproché (et je ne suis pas un cas isolé) de facturer trop cher mes services en me disant que si je voulais vraiment aider un maximum de femmes à prendre la parole en public, alors il fallait que je baisse mes tarifs.
Pourtant, ma grille tarifaire est justement féministe parce qu’elle me permet d’être rémunérée à ma juste valeur. Et si l’argent te fait peur, surtout quand il faut le négocier, je te recommande la saison 1 du podcast Ma juste valeur de Insaff El Hassini, mais aussi le podcast Rends l’argent de Titiou Lecoq sur l’argent dans le couple. Tout y est !
-
A titre personnel et pour s’affirmer
Et puis il y a « les gens ».
Nous.
Toi et moi, à titre individuel, dans la vie quotidienne sans être les porte-paroles officielles d’associations ou de collectifs, nous portons déjà une parole engagée.
- Toi qui parles écologie au repas de Noël avec Tonton viandard ;
- Toi qui parles école alternative et éducation positive avec Roland pour qui une fessée n’a jamais tué personne ;
- Toi qui expliques à cette dame que non, son aide-soignante noire (dont elle dit qu’elle est étrangère, mais qui est née en France donc Française) n’est pas feignante ;
- Toi qui expliques le sexisme ordinaire à Lionel et Farid de la compta…
Ce sont des prises de paroles engagées.
Elles portent tes convictions, tes valeurs.
Elles défendent un intérêt.
Il est tout à la fois personnel, collectif et d’intérêt général… car oui, si chacune et chacun œuvrait pour plus d’écologie, d’éducation positive et d’égalité, le monde irait mieux. Et c’est déjà tenir des propos engagés que de l’exprimer ici.
Les risques de prendre la parole pour défendre une cause
Et s’engager, c’est prendre des risques. C’est d’ailleurs bien parce que c’est risqué que parfois on n’ose pas, que parfois on se tait, que parfois on laisse couler…
-
Le rejet
Le premier risque, c’est celui d’être rejetée. Ça ne paraît peut-être rien dit comme ça ou au regard des risques que prennent, par exemple, les journalistes qui dénoncent des crimes ou des délits.
Et pourtant… le rejet est un risque pris très au sérieux par notre cerveau.
Nous sommes des mammifères sociaux. Être rejetée, c’est risquer de ne plus faire partie du groupe et de ne plus avoir accès à la nourriture. Notre cerveau est très archaïque et la peur du rejet tient de l’instinct de survie.
-
La stigmatisation
La stigmatisation ajoute au rejet le blâme et le mépris. Et si vous avez déjà défendu une position féministe ou écolo dans un cadre qui ne s’y prêtait pas… vous connaissez ces regards méprisants et ces blagues de mauvais goût envers celle qui est perçue comme « la féministe de service » ou l’« écoterroriste » du 1er étage…
-
La sanction
Plus loin encore, certaines prises de position peuvent amener à être sanctionnées. Notamment en milieu professionnel. Combien de promotions ne sont pas attribuées après avoir osé parler pour briser un silence ?
-
Violences et harcèlement
Et puis parfois, l’impensable se produit, évidemment.
Évidemment parce que dans la tête de certains, ce n’est pas si impensable que ça.
Et puis je parle ici au masculin parce que les violences sont majoritairement le fait d’hommes (je te renvoie au fabuleux ouvrage Le coût de la Virilité de Lucile Peytavin sur ce sujet) et qu’une femme meurt tous les deux jours en France sous les coups d’un homme, souvent un conjoint, concubin ou ex.
Et il n’y a même pas besoin d’avoir osé porter une parole militante pour subir harcèlement et violences.
Donc à fortiori, quand on le fait, le risque est d’autant plus grand.
-
La tache d’huile ou la confusion entre les sphères pro et perso
Et sans aller jusqu’à des violences (qu’elles soient physiques ou psychologiques), le simple fait de devoir défendre nos convictions sur de multiples terrains est parfois un poids.
C’est le cas lorsque l’on se retrouve à parler féminisme au bureau, par exemple. Been there, done that.
Mais l’inverse est aussi vrai.
Parfois, via notre job on s’ouvre à des champs militants et on les rapporte inexorablement dans notre vie privée. Je pense à ce pote ingénieur qui bossait sur des éoliennes. Ce qui aurait pu n’être qu’un job est devenu une conviction. Et il se retrouvait un peu trop souvent à défendre l’éolien dans les dîners de famille ou les soirées entre ami·es.
-
L’accusation de se faire de l’argent sur le dos de la cause
Je l’évoquais un peu plus haut, l’accusation de se faire de l’argent sur le dos d’une cause est aussi très pesante.
Je le vis en tant que formatrice et consultante ouvertement féministe (voir plus haut).
Je l’ai aussi vécu en tant que salariée associative.
Comme beaucoup de salarié·es de ce secteur, je donnais beaucoup de mon temps en plus de ce qui était écrit sur mon contrat de travail. L’économie sociale et solidaire est un très mauvais employeur pour le respect du droit du travail et notamment du temps de travail. C’est un fait peu connu de celles et ceux qui n’y sont pas, mais c’est un fait important. Un excellent ouvrage de Pascale Dominique Russo, intitulé Souffrance en milieu engagé en fait état parmi d’autres maux et non-dits du secteur.
Et quand je disais à des bénévoles que, non je ne pourrai pas être à telle réunion ou à tel événement parce que je prenais des congés ou des RTT, il m’est arrivé plus d’une fois qu’on me rétorque « ah ben ça va, c’est à ça qu’elles servent nos cotisations ? Parce que nous on est bénévoles, on paye pour venir et les salarié·es sont en vacances pendant ce temps-là ! ».
Ce n’est pas un cas isolé, loin de là.
J’ai même reçu un mail d’un président d’association qui m’expliquait que comme j’étais salariée, j’étais à son service et que je devais répondre à ses questions sans le renvoyer vers mes collègues parce qu’il n’avait pas le temps pour ça.
Je précise que j’étais en arrêt maladie suite à une opération chirurgicale, qu’il le savait, et que j’avais malgré tout répondu à son précédent mail.
Il se trouve que le DG de l’association était en copie de cet échange et a immédiatement décroché son téléphone pour me rassurer et me dire de me reposer sans ouvrir mes mails.
Il connaissait le droit du travail, lui. Il était DG, donc salarié.
Et en faisant cela, il a autant pris soin de moi que des intérêts de la structure… parce qu’en m’apaisant il s’est très probablement dit qu’il allait désamorcer une colère qui aurait pu aller jusqu’aux Prud’hommes…
Mais dans l’ESS on ne va pas aux prud’hommes pour si peu.
On desservirait la cause. Et on se ferait de l’argent sur son dos.
Au détriment de la protection des droits des travailleurs et travailleuses… oui.
On touche là l’un des paradoxes de l’engagement et du militantisme. On n’a pas tellement le droit de se plaindre, vu qu’on fait quelque chose qu’on aime et qu’on a choisi !
-
Mansplaining et le renvoi au genre
Et puis, parfois prendre la parole pour défendre une cause, c’est prendre le risque de se faire silencier.
On se dit que ça ne sert à rien de prendre la parole parce qu’on va se la faire couper. Très souvent par un homme (statistiquement parlant) et très souvent pour se faire mansplainer. Je précise tout ça dans mon article sur les stratégies pour se faire entendre quand on est une femme.
Et quand on veut bien les laisser parler, c’est alors d’autres critiques genrées qui s’abattent sur les femmes. Si ses propos sont tenus avec fermeté ou même avec colère, alors la femme sera critiquée pour son autoritarisme et sa froideur, si ce n’est renvoyée à une condition hystérique. Un homme dans les mêmes conditions sera loué pour sa ténacité, sa poigne et son leadership.
A l’inverse, qu’elle fasse la moindre petite erreur ou qu’elle bafouille, une femme sera une « pauvre fille », une « cruche » ou une « écervelée ».
Le droit à l’erreur a aussi des préférences genrées, apparemment…
Et franchement, là, tout cumulé, la peur (et la flemme aussi) prend parfois le dessus et de nombreuses femmes (mais pas que) reculent carrément devant l’idée de prendre la parole pour défendre une cause…
Parce qu’au-delà de faire face à tous ces risques, porter une parole militante expose aussi à des conséquences pour soi-même, sa santé et son bien-être.
Les conséquences sur soi quand on porte une parole engagée
-
L’injonction à la perfection
C’est peut-être le moindre des maux que je m’apprête à lister. Lorsque l’on milite pour une cause, la société et l’entourage s’attendent à ce que l’on soit exemplaire. Il n’est pas admis qu’on ne soit pas engagée dans tous les aspects de notre vie et à chaque instant.
Si tu défends l’écologie, le moindre écart pourrait discréditer ta parole, surtout si tu es une femme et si tu es jeune.
Bon, sauf évidemment si tu es Harrison Ford qui pète une durite sur l’urgence climatique devant les médias, mais que tu déplaces en jet. Là, ça ne va pas trop jaser (sauf dans quelques chroniques satiriques).
C’est inversement proportionnel à ta célébrité.
Tu peux aussi être Léonardo DiCaprio et faire tout un film qui dénonce l’inaction et passer tes vacances sur un yacht hyper pollueur… Il se fait (un peu) critiquer, mais il est quand même vu comme quelqu’un d’engagé.
Le paradoxe des puissants.
Mais en dehors de ces contre-exemples criants, défendre une cause implique de s’y tenir à chaque instant. Et ça devient pesant pour certaines, parfois.
Quoi Gérard a fait une blague sexiste et t’as rien dit ? T’es pas si féministe que ça alors !
Quoi, t’es écolo et tu manges pas bio à tous les repas ?
Quoi t’es soi-disant « zéro déchet » et tu n’achètes pas TOUT en vrac ?
Avec cette injonction à la perfection, tu la sens la fatigue, là ?
-
Le mal-être et la fatigue
Appelons ça la flemme, la fatigue générale ou « le baissage de bras ».
Toustes les militant·es l’ont ressenti à un moment ou à un autre. C’est d’ailleurs pour ça que les mouvements sociaux s’essoufflent au bout de plusieurs actions de grèves ou de blocages.
Porter une parole engagée, c’est répéter, répéter, répéter. Encore et toujours les mêmes idées, parfois avec des mots différents, parfois avec des mots identiques.
Porter une parole militante, c’est éduquer des gens sur des sujets dont parfois ils n’avaient pas conscience (au mieux) ou auxquels ils n’accordent que peu d’importance, voire dont ils se foutent royalement (au pire).
Se faire porte-parole d’une cause, c’est amener les gens vers la réflexion, c’est argumenter, c’est donner des preuves, apporter des sources, documenter ses dires…
C’est fatigant.
Mais s’il n’y avait que ça…
-
Le burn-out militant et l’épuisement émotionnel
On l’aura compris, être porte-parole, que ce soit à titre individuel ou collectif, voire institutionnel, ce n’est pas de tout repos. Ça met le cerveau en ébullition et en alerte.
Pas ou peu de répit.
Porter une parole engagée, c’est confondre parfois sa propre parole et la cause elle-même, c’est même confondre parfois sa propre personne et la cause elle-même. C’est moins le cas quand on est porte-parole institutionnelle (= qu’on est payée pour ça, que c’est notre boulot)… mais pas forcément.
Et certain·es en viennent à faire un burn-out militant. Les témoignages sont de plus en plus nombreux, comme en témoignait cet article de Slate sur le burn-out des militantes féministes paru en 2019.
Ce risque de burn-out militant est particulièrement présent dans les causes qui impliquent des souffrances humaines. Car prendre la parole, ouvre le champ des possibles à d’autres voix, d’autres témoignages en échos. Et cela peut se traduire par une onde de choc insoutenable lorsque l’on n’est pas formée pour accueillir et écouter ces paroles qui amplifient la nôtre.
Il est aussi très présent dans le militantisme écolo.
Parce qu’être conscient·e des enjeux climatiques et agir, c’est s’infliger une charge mentale supplémentaire pour organiser une logistique quotidienne respectueuse et réfléchie dans un monde qui nous offre :
- la facilité avec les emballages à usage unique (vs acheter en vrac et donc penser à amener ses sacs en tissus et ses boîtes en verre au marché),
- les déplacements en voiture individuelle (vs calculer les horaires de correspondance entre les trajets en train et en bus ou vélo)
- et des produits ménagers chimiques tous prêts (vs fabriquer ses propres produits sains et tout aussi puissants).
Et bien sûr, là encore, ce sont les femmes qui trinquent le plus : Parce que la charge domestique leur revient encore en plus grande proportion qu’aux hommes.
Fabriquer sa lessive, utiliser des couches lavables, faire les courses dans les magasins de petits producteurs bio, faire des courses en vrac… ce sont majoritairement les femmes qui s’y collent et font donc des green burn-out, comme l’expliquait le magazine Infrarouge en 2021.
-
La colère permanente
Et puis, bien sûr, la colère permanente guette la porte-parole.
Colère de répéter les mêmes choses encore et encore.
Colère de ne pas être entendue ni écoutée.
Colère que le monde n’avance pas pour prendre conscience de l’importance de la cause que l’on défend.
Colère que le monde n’agisse pas.
Colère, colère, colère.
À la fois puissante motrice des révoltes et révolutions et puissant carburant des luttes en tout genre.
Mais puissante force destructrice intérieure aussi.
On ne peut pas être en colère et apaisée, sereine et joyeuse à la fois (ou alors, donnez-moi la recette, et, non, la méditation ne m’aide pas. Pas pour ça en tout cas.).
Mais alors… pourquoi s’acharner à prendre la parole pour défendre une cause ??
Pourquoi c’est important de prendre la parole pour défendre une cause ?
-
Pour les retombées positives
Si les militant·es et les politiques ou syndicalistes continuent à se mobiliser pour faire entendre leurs opinions, c’est parce que, malgré tout… c’est relativement efficace.
On peut avoir de belles victoires et faire progresser les mentalités, voire les lois.
Grâce aux féministes des différentes époques, nous avons pu obtenir, en France :
- le droit de gagner notre propre salaire ;
- le droit d’ouvrir un compte en banque sans l’accord de notre père ou de notre mari ;
- le droit de vote ;
- la contraception ;
- l’avortement ;
- des avancées sur la parité ;
- des avancées sur l’égalité salariale (inscrite dans la loi, même si encore trop peu appliquée) ;
- et j’en passe.
Il reste certes beaucoup à obtenir. Mais je loue chaque jour les féministes qui m’ont précédée pour les progrès qu’elles ont permis.
Dans ma vie de porte-parole pro, j’ai eu le plaisir de voir les idées que je portais reprises dans la bouche de député·es à l’Assemblée nationale, des amendements adoptés, et même des lois entières passer.
J’ai la fierté de pouvoir dire que grâce à mes actions conjuguées à celles de collègues, confrères et consœurs, la condition de jeunes, d’étudiant·es, de bénévoles et de volontaires s’est améliorée.
Je peux aussi fièrement dire que j’ai contribué à sauver des vies, littéralement, en défendant l’idée de rendre obligatoires les détecteurs de fumées dans les logements (oui, ce truc qui une fois ou deux se met en route alors qu’il ne devrait pas et dont tu as enlevé la pile… stp, remets une pile très vite, c’est important ! D’ailleurs, s’il sonne de façon intempestive, c’est probablement qu’il est mal positionné dans ton logement, déplace-le et change les piles !).
Ces victoires sont galvanisantes, mais surtout, elles ne sont possibles que si on a pris la parole, qu’on a ouvert le débat, attisé les curiosités, éveillé les consciences sur le ou les sujets que l’on porte (ou qui nous portent).
Si on ne prend jamais la parole pour défendre une cause, quelle que soit l’échelle de cette prise de parole (devant 2 ou 10 000 personnes) et quel qu’en soit le support oral ou écrit (du post sur les réseaux sociaux, à la tribune dans les médias en passant par le dîner de famille), alors jamais rien ne changera.
Parce qu’en défendant une cause, on la rend audible, on la rend visible, voire on la rend acceptable.
-
Pour déplacer le champ des possibles
En lobbying politique, on appelle ça « déplacer ou élargir la fenêtre d’Overton ».
La fenêtre d’Overton, c’est l’ensemble des idées acceptées et acceptables par l’opinion publique à un moment donné. Joesph Overton était un lobbyiste d’un think tank américain libéral. C’est lui qui a théorisé ce concept de fenêtre, d’où le nom.
Si on défend une idée qui est en dehors de cette fenêtre, on fait face à une levée de boucliers.
Mais si on milite pour une idée qui est juste au bord, connexe à celles qui sont dans son champ… alors on peut petit à petit habituer l’opinion publique à cette idée et déplacer la fenêtre. Ou l’élargir un peu.
Militer, c’est donc permettre d’ouvrir (ou parfois de fermer, évidemment) le champ des possibles, le champ des idées acceptables et donc acceptées.
Évidemment, il va sans dire que cette technique est utilisée par toutes les franges du militantisme. Et l’extrême droite particulièrement… et évidemment de façon particulièrement extrême (non pas en défendant des idées qui sont juste connexes, mais en martelant des idées qui sont radicalement en dehors de la fenêtre pour faire accepter petit à petit des idées qui sont juste en dehors).
C’est bien parce que Monsieur L était inaudible ou presque avec des idées abjectes et nauséabondes très en dehors de la fenêtre d’Overton de l’époque, que celles de sa fille, un peu moins extrêmes, lui ont permis d’exploser en élargissant un peu la même fenêtre. On dit même qu’elle a « dédiabolisé » son parti… par simple effet de contraste avec les idées précédemment défendues.
Voilà pourquoi c’est important de militer pour des idées nouvelles et progressistes.
Voilà pourquoi c’est important de se faire entendre.
Voilà pourquoi c’est important de défendre une cause.
A minima pour garder nos idées dans la fenêtre d’Overton et éviter qu’elle ne se déplace dans un sens opposé. Et au mieux, pour les y faire entrer (par déplacement ou élargissement).
-
Pour l’effet repoussoir
Et puis, si on a vu que défendre des valeurs et les exprimer pouvait nous attirer des foudres des critiques, voire des trolls, voire du harcèlement… de façon assez paradoxale, mais tout aussi vraie, cette même action a aussi un effet repoussoir dans le quotidien.
Une grande majorité de celles et ceux qui ne seront pas d’accord préférera passer leur chemin et éviter de nous parler que d’engager un dialogue. Et c’est très reposant, parfois.
Alors oui, ce paradoxe veut aussi dire que celles et ceux qui seront radicalement opposés à nos idées et oseront venir nous le dire seront probablement plus tenaces et violents. Oui, c’est le risque du harcèlement dont on parlait plus haut. Oui.
Mais par exemple clairement, au quotidien, m’afficher comme féministe a permis à certaines conversations de ne pas avoir lieu en ma présence. J’ai entendu des murmures autour de moi parfois « non, tais-toi, tu vas te prendre une volée de bois vert avec cette blague, ça passera pas » ou des « je sais ce que tu vas dire donc bon, je ne vais pas m’engager sur cette voie ».
Et clairement, dans ces moments-là, j’ai juste eu un sourire intérieur et une petite voix qui me disait merci d’avoir affirmé mes idées précédemment pour ne pas avoir à le faire à ce moment précis.
Et dans mon activité pro aujourd’hui, je sais que je n’attirerai pas un client machiste qui voudrait apprendre à mieux s’exprimer en public… par autocensure, il passera son chemin si par hasard il tombait sur ce blog ou sur mes réseaux sociaux. Ça m’épargne un échange de mails, des discussions de cadrage des besoins et d’effectuer des devis ou des propositions de collaboration avant de me rendre compte d’un problème de « compatibilité d’humeur », comme on dit.
Je gagne un temps fou.
—
Ok, ok, mais concrètement, si demain je dois prendre la parole pour défendre une cause, je fais comment ?
J’y viens !
Comment prendre efficacement la parole pour défendre une cause ?
Nous voilà dans la partie technique et pratique du sujet.
Voici mes meilleurs conseils, pioche ce qui te sera utile, ignore le reste !
-
Clarté et concision
Une bonne prise de parole doit pouvoir être résumée en une phrase ; deux ou trois tout au plus. Ça signifie qu’avant même de prendre la parole, tu dois savoir quel est ton objectif : informer ? convaincre ? faire passer à l’action ?
On retient mieux les punchlines que les longs discours, en somme.
-
Des histoires, pas des bobards
Se baser sur des faits et bien connaître son sujet, notamment avec des sources, des chiffres fiables et vérifiables, c’est le pré-requis indispensable.
Ce sera toujours sur les zones de flou qu’on sera attaqué·es et déstabilisé·es… on le sait, donc autant s’y préparer et être solide sur les bases.
Demander les sources, c’est d’ailleurs aussi votre meilleure arme pour contrer un ou une adversaire. « Quand vous dîtes [ARGUMENT], sur quoi vous basez-vous pour affirmer cela ? ».
« D’où viennent les chiffres que vous avancez ? ».
En revanche, il vaut mieux ne pas commencer directement par des arguments factuels qui peuvent paraître froids et cliniques.
Une bonne technique est de commencer par une histoire.
Pourquoi ? Parce que l’humain aime les histoires, bien sûr (ça commence avec les histoires du soir quand on est enfants, et ça se poursuit avec le cinéma, la littérature, le théâtre, les séries Netflix… tout un écosystème économique est basé sur notre amour pour les histoires), mais surtout parce que commencer une prise de parole par un récit, permet de mettre tout le monde à niveau. L’auditoire partira sur la même base de réflexion.
Cette histoire permettra ensuite de poser les arguments factuels.
-
Objection, votre honneur !
En rhétorique, il existe un exercice particulièrement difficile, mais que je vous recommande absolument : le dissoï logoï.
Il s’agit de défendre un sujet à 100% avec vos meilleurs arguments, et ensuite de défendre l’exact opposé avec là aussi les arguments les plus poussés possibles. Il faut, dans l’un et l’autre des cas jouer le jeu à fond.
Pratiquer cet exercice vous permettra de dénicher les objections les plus fondamentales… et par conséquent trouver les réponses les plus percutantes.
-
Et si je sèche ?
Parfois, même avec la meilleure préparation du monde, on ne sait pas répondre.
Deux options s’ouvrent alors : s’agiter, trembler, bafouiller, tenter une diversion, rougir… ou assumer.
J’opte pour assumer et continuer la discussion sur d’autres éléments.
Comment ?
Voici un exemple : « C’est un point intéressant que vous soulevez, là. Je ne crois pas que le sujet ait été abordé sous cet angle, laissez-moi travailler cette question avec mon équipe et je ne manquerai pas de revenir vers vous pour croiser nos regards quand j’en saurai plus. En attendant, on pourrait se concentrer sur tel aspect qui me semble être le cœur de ce qui nous préoccupe aujourd’hui ».
-
S’adapter à son auditoire
Quel que soit notre sujet, à force de l’étudier, de militer, de se documenter, d’en parler… on fini par tomber dans le discours d’expert·e et par jargoniser. True story.
On y va de nos sigles et acronymes, on parle d’un concept comme s’il était connu de toutes et de tous, on fait des références culturelles ou historiques…
Si on n’y prend pas garde, on fini dans un entre-soi et c’est catastrophique pour notre cause parce qu’il faut déjà être au fait du sujet pour en comprendre les enjeux… on rate alors notre cible, qui elle, nécessairement en connaît moins que nous !
Il faut donc chausser nos lunettes de novice et déjargoniser et simplifier. Revenir aux bases.
On peut aussi :
- Soit prendre le temps de faire une pause et poser la question « si j’utilise tel mot, est-ce que tout le monde voit à quoi je fais référence ou est-ce qu’il est préférable que je fasse une courte digression ?» ;
- Soit prendre le temps de poser un concept : « pour bien être sûre qu’on parte sur la même base, quand j’emploie [MOT DE JARGON], il fait référence à [IDEE] qui a été théorisée par [AUTRICE] et signifie [DEFINITION]».
Tout le monde vous remerciera d’avoir été pédagogue.
-
Ensemble on va plus loin et l’union fait la force
Oui, j’ai sans vergogne mélanger deux dictons, pour te dire que tu peux prendre la parole à plusieurs.
Etre deux pour une prise de parole, ça permet de se soutenir ou de prendre le relais lorsque l’autre s’emmêle les concepts. Ca permet aussi d’apporter des perspectives différentes qui apportent de la profondeur au message.
En termes institutionnels, cela peut être via des partenariats de communication avec des sujets connexes (oui, un peu comme une marque de pain au lait qui s’associerait avec une marque de chocolat pour que chaque marque vende plus de son propre produit. Ça marche en marketing, ça marche en lobbying).
-
Prendre la place, surtout quand on ne nous la donne pas
C’est un peu cash, mais oui, ce n’est pas en restant assise et en laissant dire les autres que tu pourras défendre ta cause.
Ca vaut pour cette blague sexiste que tu ne laisseras pas passer et pour laquelle tu oseras dire « c’est offensant, en fait, ce que tu viens de dire là, Gérard ».
Ca vaut pour cette réflexion que tu aurais bien aimé partager à la fin d’une conférence mais… ben y’avait d’abord 3 types qui sont intervenus… longuement… et sans finir par poser une question intéressante ni ouvrir un débat, d’ailleurs, juste pour raconter leur histoire… (y’a toujours un ou plusieurs types qui prennent la parole pour finalement ne pas poser de question, à la fin des conférences… toujours). S’ils le font alors que ça saoule tout le monde, crois-moi que ta question pertinente et ta réflexion décalées seront appréciées, elles !
Si tu as les ressources et l’énergie pour… et bien n’attends pas sagement que quelqu’un te tende un micro. Parle ! Ou écris. Ou les deux.
Et si tu n’es pas en capacité (ce jour-là, sur ce sujet-là, devant ces gens) ? Alors ne le fait pas. Pas ici, pas ce jour-là, pas devant cette audience. Ce n’est pas grave de ne pas militer tout le temps.
En revanche, si on veut le faire, il faut se ménager des ressources mentales et des espaces qui nous sécurisent et nous ressourcent.
-
Avoir des ressources mentales
Ah, les ressources mentales… le nerf de la guerre quand on prend la parole pour défendre une cause qui nous tient à cœur. Parce que soyons honnêtes, il faut parfois une dose d’endurance mentale digne d’une marathonienne pour rester debout face aux vents contraires.
Les ressources mentales, c’est ce qui nous permet de rebondir après un débat houleux où nos arguments semblaient glisser sur un mur d’incompréhension. C’est ce qui nous donne le courage de nous relever après une défaite, une critique virulente, ou une journée où le monde semble avoir tourné à l’envers.
Comment renforcer ces ressources ? Certaines trouvent refuge dans la méditation, le yoga, ou la pratique régulière d’une activité qui les ressource. D’autres se tournent vers l’art, l’écriture, ou la musique pour libérer les tensions accumulées.
Quelle que soit la méthode choisie, l’essentiel est de trouver ce qui fonctionne pour soi. Car c’est en prenant soin de notre esprit que nous serons mieux armées pour continuer à porter nos idées et à défendre nos convictions.
-
Connaître ses limites
Savoir jusqu’où nous pouvons aller, quand il est temps de faire une pause, de reculer, voire de dire non, est aussi crucial que de savoir quand prendre la parole. Nous ne sommes pas des machines inépuisables, même si parfois nous aimerions l’être pour mener à bien nos combats.
Il est important de reconnaître nos limites personnelles, de respecter nos besoins physiques et émotionnels. Si cela signifie prendre une journée de repos, dire « non » à une sollicitation supplémentaire, ou demander de l’aide, alors c’est exactement ce qu’il faut faire.
-
Outils de gestion du stress
Le stress, cet indésirable qui s’invite souvent dans nos vies d’activistes et de porte-parole. Mais saviez-vous qu’il existe des outils pour l’apprivoiser ? La respiration profonde, la pratique de la pleine conscience, ou même simplement s’accorder quelques minutes de calme chaque jour peuvent faire des merveilles pour notre santé mentale.
Pourquoi ne pas essayer une séance de méditation guidée, une promenade en pleine nature, ou tout simplement un moment de silence loin de l’agitation du monde ? Ces petites pauses peuvent sembler insignifiantes, mais elles sont en réalité des bouées de sauvetage dans l’océan parfois tumultueux de l’engagement militant.
-
Prendre soin de soi
Enfin, prenons un instant pour parler de prendre soin de soi. Cela va bien au-delà de la simple gestion du stress. C’est aussi manger sainement, dormir suffisamment, faire de l’exercice, et se permettre des moments de plaisir et de détente.
Lorsque nous prenons soin de notre corps, nous renforçons notre esprit. Lorsque nous écoutons nos besoins et nos envies, nous devenons plus résilientes face aux défis qui se dressent sur notre chemin.
Alors, rappelons-nous :
- C’est ok de ne pas monter au créneau à chaque fois, de laisser passer, de se protéger. Nos batailles sont nombreuses, et parfois il est nécessaire de recharger nos batteries pour mieux revenir.
- C’est ok de se dire que la tâche est trop grande. On ne peut pas convaincre tout le monde, tout le temps. Parfois, la meilleure action est de se concentrer sur ce que l’on peut faire ici et maintenant, sans se laisser épuiser par l’immensité des défis.
En fin de compte, que nous soyons porte-parole d’une cause locale ou militante d’une grande envergure, notre capacité à prendre soin de nous-mêmes détermine en grande partie notre capacité à prendre soin des autres et à défendre nos idées avec force et détermination.
Ainsi, en prenant soin de nos ressources mentales, en reconnaissant nos limites, en utilisant des outils de gestion du stress et en prenant soin de nous-mêmes, nous nous armons pour être des porte-parole plus fortes, plus résilientes, et plus efficaces.
Alors, que ce soit avec un livre, une tasse de thé, ou simplement un moment de silence, prenons ce moment pour nous, pour recharger nos batteries et continuer à faire entendre notre voix dans ce monde qui a tant besoin de changement.
***
Prêt·e à Passer à l’Action ?
Si vous êtes inspiré·e par les idées et les conseils partagés dans cet article, je donne des formations pour prendre la parole en public : prenez contact pour votre association, votre entreprise, votre collectif 😉